Présentation
L'historien Michel Pastoureau nous raconte l'histoire occidentale du jaune.
Jaune, l'histoire du déclin d'une couleur, pourtant quasi sacrée dans l'Antiquité.
Un long déclin que rien n'aura arrêté, pas même la valorisation du jaune par la science, laquelle l'a promu au rang de couleur primaire (de la synthèse soustractive).
Le jaune aura été victime de tous les vices auxquels on l'a associé. Victime aussi de la concurrence de sa propre nuance – prestigieuse – le doré.
Jaune, couleur ô combien paradoxale.
Citations et vocabulaire
Plantes
2 citations
|27
La gaude, grande plante herbacée qui pousse sur de nombreux terroirs, est en Europe, de l'Antiquité jusqu'au XIXe s., la principale plante utilisée pour teindre en jaune.
n.f. #Teinturerie Plante tinctoriale (du genre des résédas) donnant un colorant jaune. Taxon : Reseda luteola
65
Les teinturiers "barbares" teignent en jaune non pas avec du safran ni même de la gaude mais avec du genêt, de l'ajonc, de l'ortie, de la fougère, voire avec des feuilles de frêne ou de l'écorce d'aulne.
n.m. Les frênes sont des arbres des forêts tempérées ; ils font partie de la famille des oléacées. Leur bois est utilisé en menuiserie. Taxon : Fraxinus
n.m.
- Les aulnes (ou aunes) sont des arbres poussant sur les sols humides ; ils font partie de la famille des bétulacées. Taxon : Alnus
- …▼
n.m. Les ajoncs constituent un genre d'arbrisseaux et de buissons fleurs jaunes de la famille des fabacées. Ils sont aussi appelés genêts épineux. Taxon : Ulex
Liste de molécules
4 citations
|23
Sur les murs des cavernes […] les pigments noirs sont à base de charbons végétaux ou d'oxyde de manganèse ; les jaunes proviennent de terres argileuses riches en ocre.
n.m.
- …▼
- Peinture Dioxyde de manganèse : composé chimique utilisé comme pigment noir. champ : noir
32
En Égypte […] le corps des dieux et des déesses est souvent peint en jaune vif, au moyen de pigments à base d'orpiment (sulfure naturel d'arsenic).
n.m. Peinture « Sulfure jaune d'arsenic, naturel ou artificiel, employé en peinture, différent du sulfure rouge qui contient moins de soufre et qu'on nomme réalgar. » dixit Littré champ : orange
133
D'où parfois le recours à l'or mussif, faux or plus ou moins roux, obtenu à partir de soufre, d'étain, de mercure et de sel d'ammoniaque.
133
Si la proportion d'étain est faible, la température peut rester modérée (entre 300 et 600 degrés) ; on obtient alors le massicot, jaune d'or, souvent qualifié par les textes de "beau jaune".
n.m. « Monoxyde de plomb de couleur jaune, qui une fois soumis à la chaleur cristallise en se refroidissant, devient rouge, et se nomme alors litharge. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0. champ : jaune
Noms de couleurs et de nuances
3 citations
|92
Dans les romans arthuriens, la plupart des reines et des héroïnes sont blondes, de même que les preux chevaliers qu'elles entrainent sur les chemins de l'amour et de l'aventure.
143
Ce que nous appelons "jaune citron" ou "jaune canari" ne se voit que sur des natures mortes, et seulement pour peindre quelques fruits (coings, pommes, poires) ; ce sont des nuances qui paraissent absentes du vêtement...
176
Un cas spectaculaire est celui de l'Ukraine qui, à la suite des élections présidentielles frauduleuses de novembre 2004, vit éclater une "révolution orange", couleur de salut public omniprésente dans les manifestations.
n.propr. (f.) État d'Europe de l'Est, situé entre la Biélorussie et la mer Noire.
Les pays du monde
4 citations
|155
La Chine est à la mode et le reste jusque dans les années 1780, soutenue par un fort courant de sinophilie.
157
Les peintres […] et les écrivains orientalistes qui visitent le Maghreb ou la Palestine sont frappés par la lumière intense qui y règne, mais ils ne voient guère de jaune dans les tentures ni dans les vêtements.
n.propr. (f.) État du Proche-Orient (nom officiel : État de Palestine).
- adj.
- n. « Celui qui se livre à l'étude des choses de l'Orient. » dixit Académie 8
176
Un cas spectaculaire est celui de l'Ukraine qui, à la suite des élections présidentielles frauduleuses de novembre 2004, vit éclater une "révolution orange", couleur de salut public omniprésente dans les manifestations.
n.propr. (f.) État d'Europe de l'Est, situé entre la Biélorussie et la mer Noire.
181
Le premier "carton jaune" officiel fut exhibé le 31 mai 1970 par l'arbitre du match d'ouverture de la Coupe du Monde, Mexique-URSS.
n.m.
Divers
26
Les plus anciens témoignages de jaunes fabriqués par l'être humain sont donc ces pigments à base de d'ocre ; longtemps ils sont restés les seuls.
28
Les céréales, l'huile, le miel, la cire, tous produits dont le jaune restera la couleur emblématique jusqu'à nos jours.
n.f. « Substance jaunâtre produite par les abeilles et avec laquelle ces insectes composent les alvéoles où ils déposent leur provision de miel et élèvent leur progéniture. » dixit Littré
29
Les hommes et les femmes de la préhistoire ne semblent pas avoir été intéressés par l'or, absent des tombes et des dépôts votifs.
n.f. « Histoire de l'homme avant les temps où l'on a des documents ou traditionnels ou écrits. » dixit Littré
29
Au chalcolithique (âge du bronze) […] l'or non seulement est de plus en plus présent dans les sépultures, mais il commence à être offert aux dieux puis thésaurisé.
- n.m. Préhistoire « Période préhistorique de transition entre le Néolithique et l'âge du bronze. » in Wiktionnaire - licence CC 3.0.
- adj. …▼
29
Dans les rivières, [l'or] se présente en fines parcelles (paillettes), ailleurs en masses plus ou moins grandes, dépourvues de gangue et faciles à extraire (pépites).
30
L'or est facile à extraire, à transporter, à travailler et, contrairement à la plupart des autres métaux, il peut se marteler à froid.
30
De bonne heure, le métal précieux (l'or, NDLR), est thésaurisé sous différentes formes : anneaux, colliers, boules, perles, fils, plaques, rubans, torques, lingots, avant de servir d'instrument d'échange.
n.m. #Archéologie Collier rigide, formé d'une tige de métal, dont les extrémités sont plus ou moins travaillées.
À propos de ce livre
La couverture (en haut de la présente page) correspond à l'édition beau livre (parue chez Seuil en 2019).
Les numéros de page (ci-dessus) correspondent à l'édition poche (parue chez Points en 2022).
| Titre | Jaune ~ Histoire d'une couleur | Auteur | Michel Pastoureau | Année de parution | 2019 | Éditeur original | Seuil | Année de cette édition | 2022 | Éditeur de cette édition | Points | ISBN | 978-2-7578-9221-3 | Nombre de pages | 188 |
|---|
Commentaire
Ajouter un
commentaire
commentaire
¿ Votre prochaine étape ?
un mot ?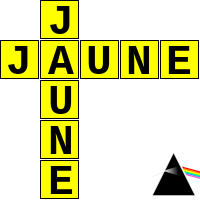
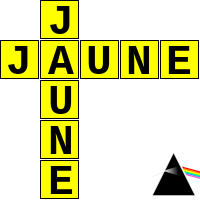
- JAUNE
une tonalité ?

- Dico jaune
- 52 mots

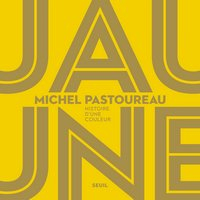





Le jaune compte parmi les plus anciennes couleurs que l'homme a fabriquées pour peindre (notamment grâce à l'ocre).
Comment la couleur, longtemps associée uniquement à un objet matériel (p. ex. une fleur jaune), est-elle devenue une abstraction (p. ex. le jaune) ? La liturgie et l'héraldique ont joué un rôle. Michel Pastoureau rappelle que les premiers codes de couleurs pour les vêtements liturgiques remontent à la naissance des armoiries. Liturgie et héraldique ont cela en commun qu'elles ne connaissent qu'un nombre limité de couleurs (et que les nuances ne comptent pas). Mais l'héraldique prend en compte le jaune. Dans le langage héraldique, on dit "or" pour jaune, ce qui est plutôt prestigieux pour la couleur jaune.
Une même pierre peut avoir différentes colorations. Ainsi, dans les textes anciens, parler d'or n'implique pas forcément la couleur jaune.
L'or a pu être considéré comme une lumière matérialisée, d'essence divine donc, d'où sa présence dans des lieux de culte.
Michel Pastoureau rappelle que l'or a aussi des mauvais aspects. Il symbolise la convoitise, la cupidité etc.
La symbolique du jaune est tardive. Absente de la liturgie, peu mentionnée par les Pères de l'Église et dans la Bible (alors que l'or y est omniprésent).
Toutes les couleurs sont ambivalentes. Mais au Moyen Âge, le jaune n'est associé qu'à des vices, sauf quand il est associé à l'or. Michel Pastoureau avance plusieurs hypothèses pour comprendre ce désamour du jaune. L'une d'elle implique la notion de colère, grave péché selon l'Église et que la médecine d'alors explique par un excès de bile, laquelle est jaune. Or, la bile des animaux, c'est le fiel – il y a un lien phonique évident entre fel (fiel) et felon (cruel, perfide – qui a donné "félon").
Michel Pastoureau se demande dans quelle mesure l'iconographie (p. ex. représenter un traître habillé en jaune) a influencé les usages quotidiens. Force est de constater que si le jaune a pu être volontiers porté par les Toscanes au milieu du XIVe s. (d'après des inventaires de notaires), deux siècles plus tard ce n'est plus le cas, en Toscane et nulle part ailleurs, et ce ne sera plus jamais le cas. L'image de Judas vêtu de jaune a joué un rôle dans la dévalorisation de cette couleur (Michel Pastoureau doute que dans les villes d'Occident les juifs aient souvent porté des habits jaunes ; l'iconographie aurait amplifié le fait que certains juifs portaient la rouelle – insigne jaune discriminatoire). À propos des marques discriminatoires, rappelons qu'au Moyen Âge une partie non négligeable de la population devait en porter : celles et ceux qui exerçaient une profession dangereuse ou déshonnête (bourreau, chirurgien...), les condamnés, les infirmes et bien sûr les non-chrétiens (au premier rang desquels les juifs). Mais les usages varient avec le temps et le lieu. Concernant la prostitution, rappelons que les villes n'ont jamais su trop comment s'y prendre avec les prostituées : faut-il les cacher ou au contraire leur imposer de porter un signe ostensible pour les distinguer des "honnêtes" femmes ?
Pour enfoncer le clou, la couleur jaune aura ensuite subi de plein fouet la chromophobie des réformateurs protestants ; le jaune, une couleur pas assez austère à leur goût.
La réputation négative du jaune explique sa rareté dans l'art, la culture matérielle (habillement, mobilier) et les symboles. Curieusement, cela ne changera jamais, malgré la promotion scientifique du jaune au XVIIe s. Le jaune est l'une des trois couleurs primaires de la synthèse soustractive, avec le bleu (ou cyan) et le rouge (ou magenta).
Michel Pastoureau s'interroge sur l'absence dans la langue du mot "jauneur" (et "bleueur"), alors que les quatre autres couleurs principales ont engendré noirceur, blancheur, rougeur, verdeur. Le jaune et le bleu ont acquis leur statut de couleur plus tard que les autres, ceci explique peut-être cela.
« À partir du XIIIe s., la symbolique du jaune se dégrade fortement et évoque tour à tour l'envie, la jalousie, le mensonge, le déshonneur et la trahison. »
Michel Pastoureau évoque la naissance de la couleur orange (longtemps considérée comme une simple nuance), au Moyen Âge.
Michel Pastoureau rappelle que Van Gogh a souvent été trahi par l'instabilité de la couleur jaune, du moins à cause du pigment qu'il utilisait (le jaune de chrome, moins stable mais meilleur marché que le jaune de cadmium).
Michel Pastoureau rappelle que le beige aura connu une grande promotion au XXe s. (gagnant son statut de couleur à part entière ; il n'est plus une simple nuance), peut-être favorisé par le rejet du jaune. Rejet à la ville seulement, car au sport et à la plage, le jaune prend sa revanche !
Michel Pastoureau rappelle que si le jaune est boudé, c'est seulement en Occident. En Asie, il est très présent sur les vêtements et les étoffes. En Chine, c'était même la couleur impériale.