Présentation
L'historien des couleurs Michel Pastoureau nous raconte l'histoire européenne de la couleur verte. Couleur difficile à fixer sur les vêtements (les teintures ayant longtemps été d'origine végétale), le vert symbolise l'instabilité, le changement, le hasard (cf le tapis vert dans les casinos). Couleur tout à fait ambivalente : courtoise et d'espérance, et en même temps diabolique et maudite (cf superstition théâtrale). Un temps mis de côté par la science (n'étant pas une couleur primaire, mais produite à partir du jaune et du bleu), le vert amorce son retour à la fin du XVIIIe s. (avec le romantisme par le truchement de la végétation) puis depuis la fin du XXe s. en tant que couleur du mouvement écologique. Bref une couleur aujourd'hui au centre de toutes les attentions.
Citations et vocabulaire
Animaux et plantes
- Les aulnes (ou aunes) sont des arbres poussant sur les sols humides ; ils font partie de la famille des bétulacées. Taxon : Alnus
- …▼
- Les noyers constituent un genre d'arbres de la famille des juglandacées ; leur fruit est la noix. Taxon : Juglans
- …▼
Le vocabulaire du Moyen Âge
Le vocabulaire de la Rome antique
- …▼
- #Antiquité#Romaine « Cirque disposé pour les courses de chevaux et de chars. » dixit Académie 8
Le vocabulaire du catholicisme
- #Catholicisme « Longue bande d'étoffe que les officiants portent au cou, lorsqu'ils remplissent certaines fonctions ecclésiastiques, et qui pend des deux côtés par-devant. » dixit Académie 8
- …▼
Divers
À propos de ce livre
La couverture (en haut de la présente page) correspond à l'édition beau livre (parue chez Seuil en 2013).
Les numéros de page (ci-dessus) correspondent à l'édition poche (parue chez Points en 2020).
| Titre | Vert ~ Histoire d'une couleur | Auteur | Michel Pastoureau | Année de parution | 2013 | Éditeur original | Seuil | Année de cette édition | 2020 | Éditeur de cette édition | Points | ISBN | 978-2-7578-8706-6 | Nombre de pages | 221 |
|---|
Commentaire
commentaire

- Dico vert
- 23 mots

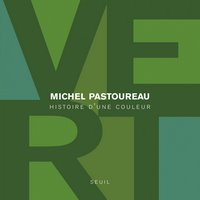






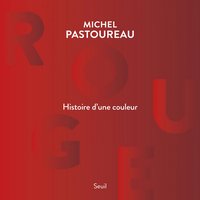

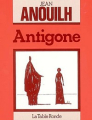 Antigone
Antigone
Chez les poètes antiques, une vraie couleur, c'est surtout une couleur fabriquée (cf peinture et teinture), pas une couleur présente dans le monde naturel.
Dans la Rome antique, on n'aime pas spécialement le vert (à la différence des Germains (les barbares), et des Égyptiens).
"La traduction des termes de couleur est toujours une trahison."
À propos du vert en tant que couleur de l'Islam : les tapis ne sont jamais verts, car on ne piétine pas une couleur vénérable.
Pour la sensibilité médiévale, les couples rouge/vert et rouge/jaune ne présentent pas un contraste fort.
En Occident, le vert est symbole d'espérance depuis longtemps. Dans la Rome antique, on enveloppait parfois de vert le corps d'un nouveau-né.
Le vert est aussi la couleur de l'espérance de maternité et des enceintes (cf le tableau Les Époux Arnolfini).
Michel Pastoureau s'interroge sur la faible présence du vert dans les armoiries, d'autant plus surprenante qu'il s'agit d'une couleur valorisée par la chevalerie. Plusieurs hypothèses :
La Réforme protestante place le vert dans la catégorie des couleurs immorales.
Aspects négatifs des pigments verts :
Depuis quand les peintres mélangent-ils du bleu et du jaune pour faire du vert ? Apparemment, depuis récemment. Aucun document de l'Antiquité ou du Moyen Âge ne témoigne d'une telle pratique. Et aucune analyse en laboratoire non plus. La chose est devenue théorique suite à la découverte du spectre (par Newton, en 1666) : là, le vert se situe entre le bleu et le jaune. Au XVIIIe s. des manuels de peinture parlent de fabriquer du vert à partir de bleu et de jaune. En revanche, certains enlumineurs procédaient ainsi dès le XIVe s.
Le siècle des Lumières ne brille pas seulement par l'esprit : les éclairages s'améliorent, les couleurs se voient mieux.
Au XVIIIe s., la mode du bleu est néfaste au vert, car on prétend que ces deux couleurs s'accordent mal (cf le proverbe anglais Blue with green should never been seen). De plus, à la lueur des chandelles, le vert risque de brunir ou de s'affadir. Sans compter la mauvaise réputation que traine toujours le vert (couleur chimiquement dangereuse et couleur démoniaque).