Présentation
L'historien des couleurs Michel Pastoureau nous raconte la fascinante histoire du rouge. Couleur très tôt maîtrisée par les peintres et les teinturiers. Couleur ambivalente au possible : le pouvoir, la violence, l'amour. Couleur décriée par les réformateurs protestants. Quasiment absente de nos garde-robes occidentales, le rouge n'a rien perdu de sa force symbolique.
Citations et vocabulaire
Animaux, plantes et champignons
31
Prudence écrit à une époque où le [mithraïsme] est en régression et où rares sont les fidèles de cette religion qui continuent de croire aux vertus purificatrices du sang du taureau.
TAUREAU, X
n.m. Bovin domestiqué par l'homme depuis plus de 10.000 ans. (Synonymes : bœuf domestique, vache (femelle)). Taxon : Bos taurus n.m. #Religion #Antiquité#Romaine Culte de Mithra ; religion d'origine iranienne, très populaire dans la Rome antique, fameuse pour ses sacrifices de taureaux.
PURIFICATEUR, TRICE
- adj. #Religion Qui purifie.
- n.
33
À Rome, les fleurs rouges et violacées jouent souvent le rôle de fleurs funéraires, surtout celles qui perdent rapidement leurs pétales, comme le pavot ou la violette.
n.m. Pavot à opium : plante herbacée, du genre des papavers, aux propriétés psychotropes sédatives. Taxon : Papaver somniferum
42
Dans la gamme des rouges, les deux colorants principaux [des Égyptiens] sont la garance et le kermès, mais on trouve aussi des traces de la pourpre, du carthame et du henné.
n.m.
- #Teinturerie « [Insecte (de la super-famille des cochenilles)] qui vit sur un petit chêne vert et qui donne une belle teinture écarlate. » dixit Académie 8 Taxon : Kermes vermilio
- …▼
- n.f.
- …▼
- #Teinturerie Matière colorante tirée du rhizome de la garance. champ : rouge
- adj.inv. …▼
42
Le henné est un arbuste […] dont les feuilles séchées et réduites en poudre fournissent un colorant pour teindre en rouge ou en brun-rouge les étoffes et les cuirs, le bois blanc, les cheveux, les ongles, la peau.
n.m.
- Arbuste (du genre des lawsonias), d'origine africaine, dont les feuilles sont utilisées comme colorant, notamment pour les tatouages. Taxon : Lawsonia inermis
- …▼
42
Du carthame, plante dont les fleurs ont des vertus tinctoriales, on tire un colorant, tantôt jaune, tantôt rouge.
n.m.
- #Teinturerie Carthame des teinturiers : plante herbacée de la famille des astéracées (appelée aussi safran bâtard) dont on tire un colorant et une huile alimentaire. Taxon : Carthamus tinctorius
- …▼
42
Pour les rouges, [les teinturiers grecs] […] emploient l'orseille, matière fournie par certains lichens poussant sur des rochers (d'où son nom latin de rocella) ; aux dires de Pline, la plus prisée vient des îles Canaries.
n.f. #Teinturerie « [Lichen du genre des roccellas] dont on extrait une matière colorante et qui sert à teindre les étoffes en rouge violet. » dixit Académie 8 Taxon : Roccella tinctoria
Vocabulaire de la teinturerie
7 citations
|23
Le cinabre, sulfure naturel de mercure, et […] le réalgar, sulfure naturel d'arsenic : tous deux coûtent cher, sont importés de loin et ne sont employés qu'en petite quantité ; ils sont en outre très toxiques.
n.m.
- Peinture #Teinturerie #Chimie « Nom donné au sulfure de mercure ainsi qu'au pigment qu'il fournit une fois broyé (dit aussi "vermillon"). » dixit leXicolore champ : rouge
- …▼
n.m. Sulfure naturel d'arsenic utilisé comme pigment, notamment au Moyen Âge pour les enluminures. champ : rouge
39
Le cinabre antique […], on ne sait pas le fabriquer artificiellement ; pour ce faire, il faudra attendre le haut Moyen Âge et l'apparition en Occident d'un nouveau pigment de synthèse : le vermillon.
- n.m. Couleur rouge vif.
- adj.inv.
n.m.
- Peinture #Teinturerie #Chimie « Nom donné au sulfure de mercure ainsi qu'au pigment qu'il fournit une fois broyé (dit aussi "vermillon"). » dixit leXicolore champ : rouge
- …▼
41
Nous savons par plusieurs témoignages écrits que les Égyptiens étaient d'habiles teinturiers ; Pline leur attribue même l'invention du mordançage.
42
Dans la gamme des rouges, les deux colorants principaux [des Égyptiens] sont la garance et le kermès, mais on trouve aussi des traces de la pourpre, du carthame et du henné.
n.m.
- #Teinturerie « [Insecte (de la super-famille des cochenilles)] qui vit sur un petit chêne vert et qui donne une belle teinture écarlate. » dixit Académie 8 Taxon : Kermes vermilio
- …▼
- n.f.
- …▼
- #Teinturerie Matière colorante tirée du rhizome de la garance. champ : rouge
- adj.inv. …▼
43
La garance produit des tons solides et intenses dont on a appris de bonne heure à varier les nuances en utilisant des mordants différents (d'abord chaux et urine fermentée, plus vinaigre, tartre, alun).
n.f. « Lait de chaux, blanc de chaux : chaux éteinte étendue d'assez d'eau pour s'étaler avec le pinceau et couvrir les murs comme un badigeon. » dixit Littré champ : blanc
MORDANT, E
- adj. …▼
- n.m. #Teinturerie « Substance au moyen de laquelle on parvient à fixer les couleurs sur la laine, la soie, le coton, etc. » dixit Académie 8
46
Les deux principaux [coquillages], ceux qui fournissent la pourpre de luxe, sont le purpura, qui a donné son nom à la teinture, et le murex.
128
Seule la cochenille mexicaine […] permet [aux peintres] de mettre au point dans la gamme des rouges un pigment subtil et délicat, supérieur aux anciennes laques de brésil […] pour poser un glacis sur le vermillon.
n.m. fortification « Pente douce qui part de la crête du chemin couvert et se perd dans la campagne. » dixit Académie 8
Le vocabulaire de la religion
4 citations
|29
Pendant longtemps domine l'idée que le sang appartient aux dieux et constitue leur nourriture ; d'où les sacrifices d'animaux dont le sang sert à asperger les temples, les autels, les fidèles, pour les purifier.
31
Prudence écrit à une époque où le [mithraïsme] est en régression et où rares sont les fidèles de cette religion qui continuent de croire aux vertus purificatrices du sang du taureau.
TAUREAU, X
n.m. Bovin domestiqué par l'homme depuis plus de 10.000 ans. (Synonymes : bœuf domestique, vache (femelle)). Taxon : Bos taurus n.m. #Religion #Antiquité#Romaine Culte de Mithra ; religion d'origine iranienne, très populaire dans la Rome antique, fameuse pour ses sacrifices de taureaux.
PURIFICATEUR, TRICE
- adj. #Religion Qui purifie.
- n.
70
À partir du XIIe s., le sang du Christ constitue une relique éminemment précieuse que plusieurs églises sont fières de posséder.
116
Sur le bûcher, on vêt rituellement de jaune les renégats, les apostats, les relaps et les faussaires de toutes espèces.
RENÉGAT, E
n.- #Christianisme « Il s'est dit de celui, de celle qui a renié la religion chrétienne pour embrasser une autre religion. » dixit Académie 8
- …▼
APOSTAT, E
- n. #Religion « [Personne] qui a apostasié, c'est-à-dire abandonné sa religion, renié ses vœux monastiques ou ses opinions. » dixit Littré
- adj.
RELAPS, E
n. « Celui, celle qui fait un faux acte public ou privé, une fausse signature, un objet faux, une œuvre d'art fausse. » dixit Académie 8
Noms de couleurs et de nuances
4 citations
|39
Le cinabre antique […], on ne sait pas le fabriquer artificiellement ; pour ce faire, il faudra attendre le haut Moyen Âge et l'apparition en Occident d'un nouveau pigment de synthèse : le vermillon.
- n.m. Couleur rouge vif.
- adj.inv.
n.m.
- Peinture #Teinturerie #Chimie « Nom donné au sulfure de mercure ainsi qu'au pigment qu'il fournit une fois broyé (dit aussi "vermillon"). » dixit leXicolore champ : rouge
- …▼
60
À propos du visage, [les bons auteurs romains] savent choisir le terme qui convient pour distinguer les pommettes vermeilles d'une jolie femme (roseus), la peau cuivrée d'un marin (coloratus).
65
Là où l'hébreu disait "une étoffe magnifique", le latin traduit par "pannus rubeus" (une étoffe rouge) et le français du XVIIe s., "un tissu écarlate.
- adj. « D'une couleur rouge et fort vive. » dixit Académie 8
- n.f. …▼
136
Au XVIIe s. […] c'en est fini des rouges vifs tirant vers l'orangé, la mode est aux tons carmin, lie-de-vin, cramoisi, plus ou moins brunis ou violacés.
Le vocabulaire du christianisme
4 citations
|89
Les auteurs - et les érudits qui les commentent - divergent quant à savoir si le graal est un grand plat, un calice, un ciboire, un chaudron, une corne d'abondance et même une pierre précieuse.
116
Sur le bûcher, on vêt rituellement de jaune les renégats, les apostats, les relaps et les faussaires de toutes espèces.
RENÉGAT, E
n.- #Christianisme « Il s'est dit de celui, de celle qui a renié la religion chrétienne pour embrasser une autre religion. » dixit Académie 8
- …▼
APOSTAT, E
- n. #Religion « [Personne] qui a apostasié, c'est-à-dire abandonné sa religion, renié ses vœux monastiques ou ses opinions. » dixit Littré
- adj.
RELAPS, E
n. « Celui, celle qui fait un faux acte public ou privé, une fausse signature, un objet faux, une œuvre d'art fausse. » dixit Académie 8
119
Le rouge est spécialement mis en scène lors des fêtes de l'Esprit-Saint (la pentecôte est une immense fête rouge), de la Sainte Croix et des martyrs.
n.f. #Christianisme « Fête que l'Église célèbre le cinquantième jour après Pâques, en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. » dixit Académie 8
186
Noël, qui dans le calendrier prend place peu après le solstice d'hiver, associe le vert du sapin, le blanc de la neige et le rouge du Père Noël.
Jargon des minéralogistes
5 citations
|20
Dans les salles et les couloirs des grottes […] les rouges sont le plus souvent tirés de l'hématite, un des minerais de fer les plus répandus en Europe.
25
Ainsi les amulettes en jaspe rouge qui passent pour être teintes du sang ou des larmes d'Isis, déesse de la fécondité souvent représentée sous la forme d'une génisse à robe rouge.
n.f. #Occultisme « Objet qu'on porte sur soi par superstition, dans l'idée qu'il préserve des maladies ou des maléfices. » dixit Littré
n.m. #Minéralogie « Variété de quartz, pierre dure et opaque, de la nature de l'agate. » dixit Académie 8
32
De nombreux défunts des premiers siècles avant notre ère sont entourés dans leur tombe ou leur sarcophage d'objets rouges […] : blocs d'hématite ou de cinabre ; pierres (cornaline, jaspe, grenat).
n.f. « [Calcédoine] demi-transparente, et ordinairement d'un rouge foncé, dont on fait des cachets et autres bijoux. » dixit Littré champ : rouge
55
Le rubis est la pierre rouge par excellence, une pierre pleine de vertus qui passe pour stimuler l'ardeur sexuelle, fortifier l'esprit […] ; il est souvent taillé en forme de goutte de sang.
- n.m. #Minéralogie « Pierre précieuse, transparente et d'un rouge plus ou moins vif. » dixit Académie 8 champ : rouge
- adj. …▼
- n.m. « Liquide rouge qui, circulant par les artères et les veines dans les diverses parties du corps de l'homme et des animaux y entretient la vie. » dixit Académie 8 champ : rouge
- adj.inv. …▼
149
À l'époque de Pline, les Romains distinguaient une quinzaine de nuances dans les colonnes de porphyre et dans les étoffes teintes à la pourpre, alors qu'ils ne savaient nommer que deux ou trois tons de verts et à peine plus de bleu.
Divers
14
Le danger de l'anachronisme semble guetter l'historien à chaque coin de document.
n.m. « Toute erreur qui consiste à attribuer des usages, des idées, etc., aux hommes d'une époque où ces idées, ces usages n'étaient pas encore connus. » dixit Académie 8
19
L'univers des cosmétiques demeure celui qui propose les nuances de rouges les plus diverses et les plus subtiles.
20
Il est patent que sur les corps, les rouges de la Préhistoire ont une triple fonction : déictique, prophylactique, esthétique.
- adj. #Linguistique Qui sert à désigner.
- n.m. …▼
- adj. « Qui se rapporte au sentiment du beau. » dixit Académie 8
- n.f. …▼
21
Comment les hommes du paléolithique ont-ils appris à transformer un élément terreux naturel - le minerai - en produit pouvant servir à peindre - le pigment ?
24
Le rouge aride du désert s'oppose habituellement au noir fertile de la vallée limoneuse du Nil.
25
Les scribes tracent parfois en rouge les hiéroglyphes qui évoquent le danger, le malheur ou la mort.
À propos de ce livre
La couverture (en haut de la présente page) correspond à l'édition beau livre (parue chez Seuil en 2016).
Les numéros de page (ci-dessus) correspondent à l'édition poche (parue chez Points en 2020).
| Titre | Rouge ~ Histoire d'une couleur | Auteur | Michel Pastoureau | Année de parution | 2016 | Éditeur original | Seuil | Année de cette édition | 2020 | Éditeur de cette édition | Points | ISBN | 978-2-7578-8708-0 | Nombre de pages | 190 |
|---|
Commentaires (2)
visiteur (Lukos53)
le 15/12/2025
Le RougeMagnifique livre richement illustré et résumé très complet ci-dessus.
J'ajouterais seulement quelques notes de lecture :
Un curieux "tuya" se promène p.35
De rares nuances de bleu sont précisées p.80 : vairet et sorinde (en plus des plus connues pers, azur et inde).
Les roux maléfiques, en plus de Judas : Mordret, Esaü, Saül et Caïphe.
Le rose était encore masculin au XVIIIe siècle (p.151).
Très intéressante histoire du sang bleu p.152
"Sous l'Ancien régime, le drapeau rouge n'est ni rebelle ni violent. [...] c'est un simple signale lié à l'ordre public." (p.163)
Distinction bonnet rouge/talon rouge p.166
Histoire des couleurs : une collection magnifique et toujours riche d'enseignements !
J'ajouterais seulement quelques notes de lecture :
Un curieux "tuya" se promène p.35
De rares nuances de bleu sont précisées p.80 : vairet et sorinde (en plus des plus connues pers, azur et inde).
Les roux maléfiques, en plus de Judas : Mordret, Esaü, Saül et Caïphe.
Le rose était encore masculin au XVIIIe siècle (p.151).
Très intéressante histoire du sang bleu p.152
"Sous l'Ancien régime, le drapeau rouge n'est ni rebelle ni violent. [...] c'est un simple signale lié à l'ordre public." (p.163)
Distinction bonnet rouge/talon rouge p.166
Histoire des couleurs : une collection magnifique et toujours riche d'enseignements !
Ajouter un
commentaire
commentaire
¿ Votre prochaine étape ?
un mot ?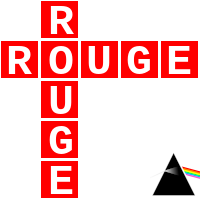
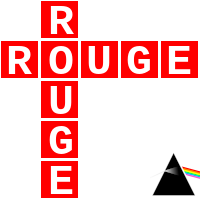
- ROUGE

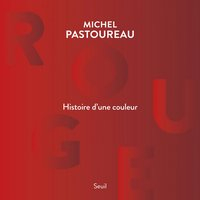









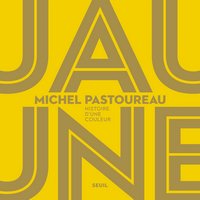
Les difficultés d'ordre documentaire auxquelles sont confrontés les historiens :
Pour l'historien, la couleur se définit d'abord comme un fait de société.
Le rouge a un statut de couleur primordiale. Dans certains langues et selon le contexte, un même mot peut signifier à la fois "coloré" et "rouge". Par exemple en latin (coloratus) et en espagnol (colorado).
Dans l'Égypte antique, le rouge du désert (aridité) s'oppose au noir des limons du Nil (fertilité). Mais tous les rouges ne sont pas négatifs, lorsqu'ils symbolisent le pouvoir, la victoire.
Ce n'est pas parce qu'on ne nomme pas une couleur qu'on ne la voit pas.
Le rouge est la couleur emblématique du feu (des civilisations anciennes jusqu'à la couleur du camion des pompiers). Pourtant, au naturel, une flamme est plus proche de l'orangé que du rouge vif. Peut-être vient-ce du fait que le feu a longtemps été considéré comme un être vivant... Y a-t-il un rapport avec le sang ?
Le sang est l'autre référent, incontestable, de la couleur rouge. Tout comme le feu, le sang est à la fois bénéfique (le sang qui circule entretient la vie) et maléfique (le sang qui coule entraine la mort).
Dans la Grèce antique, le rouge occupait sûrement la première place.
Un auteur latin du Ier siècle a du mal à parler de manière conceptuelle des couleurs : une couleur est pour lui indissociable de l'objet qui a cette couleur. Il pourra dire "j'aime les robes rouges" mais difficilement "j'aime le rouge".
Dans quelle mesure l'iconographie reflète-t-elle la réalité ? De nos jours, les rues sont pleines de gens en habits sombres ou neutres et les magazines de mode pleins d'habits multicolores...
Michel Pastoureau est toujours étonné - et il y a de quoi - par l'ingéniosité des hommes préhistoriques quant à la fabrication des pigments. Comment en sont-ils arrivés à élaborer des procédés aussi compliqués ?
Les teinturiers romains qui teignent en rouge sont classés en six catégories, en fonction des colorants qu'ils utilisent :
Les atouts de la pourpre antique :
À propos des coquillages donnant la pourpre antique :
Les fraudes sont nombreuses lors d'utilisation de la prestigieuse pourpre. L'une d'elle consiste à faire subir aux étoffes un premier bain (un "pied") de garance ou d'orseille...
Contrairement à l'image que l'on peut avoir de la Rome de l'Antiquité, il ne s'agissait pas d'une ville blanche mais plutôt rouge (à cause des briques, des tuiles et du bois (responsable d'incendies permanents)).
Les Romains avaient une grande admiration pour le coq, animal dont la crête donnait la nuance de rouge la plus vive...
« Rien n'est universel dans les faits de lexique : certaines langues ne possèdent aucun terme de couleur, pas même un mot pour dire "couleur" ; d'autres ignorent le blanc et le noir ou ne considèrent pas les mots qui les désignent comme des termes de couleur. »
En Occident, depuis l'Antiquité jusqu'aux lendemains de l'an mille, le véritable contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge.
À propos du terme "rouge" dans des noms de personne. Il peut s'agir soit de la couleur des cheveux (roux) soit du caractère coléreux ou sanguinaire.
Les Pères de l'Église semblent être les premiers à employer fréquemment les adjectifs de couleur comme des substantifs. Ainsi naît l'abstraction...
Au tournant des XIIe et XIIIe s., les fidèles chrétiens ne sont invités à communier qu'avec le pain ; le vin est réservé au prêtre, signe de l'aspect précieux du sang du Christ. Cela entraine des contestations !
Au Moyen Âge, le juge est en rouge ; il fait la justice à la place du roi, du prince. Idem pour le bourreau.
Le rouge fut la couleur la plus présente dans les armoiries (surtout nobles) : 60% de présence ! Ce chiffre ne cessera de diminuer (il faut dire que l'usage des armoiries s'est étendu à toutes les classes sociales).
« Le propre du rouge médiéval est d'être à la fois masculin et féminin, viril et plein de grâce. »
À partir du XIIe s., le rouge commence à être concurrencé par le bleu. Pourquoi le bleu ? Progrès techniques en matière de teinture ? Ou bien représentations de la Vierge Marie de plus en plus fréquentes en bleu ? Un peu des deux, mais rappelons une évidence : les peintres n'ont pas eu besoin des progrès techniques des teinturiers pour représenter une étoffe de telle ou telle couleur !
Puis c'est le noir qui concurrence le rouge ; le noir luxueux des princes ou le noir humble prôné par les réformateurs protestants. Mais cela n'affecte pas la dimension symbolique du rouge, toujours très forte. D'ailleurs, dans la langue française des XVIe et XVIIe s., le terme rouge devient synonyme de "très" ("cette robe est rouge belle"). Notons que l'association rouge et noir est particulièrement négative (elle sied aux représentations du Diable) ; cela a pu expliquer pourquoi le jeu d'échecs (d'abord rouge & noir) est devenu blanc & noir (après un passage par le blanc & rouge, l'opposition la plus nette pour la sensibilité médiévale).
Puis c'est la découverte du spectre par Newton (en 1666) : le rouge se retrouve à l'extrémité. Cela met à mal la place centrale du rouge !
Le rouge vestimentaire décline vraiment à partir du XVIIIe s. Le romantisme vantera le bleu, le vert puis le noir, pas le rouge.
En latin, le nom de fleur rosa (qui n'a pas de couleur particulière) a donné le terme roseus, qui désigne un rouge vif. Pour nommer la nuance de rouge que nous nommons "rose" (et dont on fait une couleur à part entière), c'est d'abord le terme "incarnat" qui fut utilisé. L'Académie française n'intègre l'adjectif "rose" dans son dictionnaire qu'en 1835.
C'est au XXe s. que le rose devient une couleur féminine. Perçu comme une nuance de rouge, un rouge atténué, il servait surtout pour les garçons (le rouge viril en devenir).
L'expression "quitter le rouge" signifiait "quitter la vie mondaine", ses fards, ses fards rouges. Le rouge n'a rien perdu de sa synonymie avec le terme "fard" : on dit "rouge" pour "rouge à lèvres" : "un tube de rouge".
Le vert comme couleur de l'autorisation, de la sécurité, et qui s'oppose au rouge (cf "feu rouge" vs "feu vert") n'a rien de naturel. Avant que le vert ne soit considéré comme la couleur complémentaire du rouge, il était une couleur de désordre, de transgression, d'inconstance.
Le rouge reste la couleur du théâtre et de l'opéra (cf la couleur du rideau et des sièges des spectateurs). Il met mieux en valeur les comédiens que les autres couleurs.
Le rouge reste une couleur officielle : légion d'honneur, couper le ruban rouge etc.
À propos des multiples hypothèses quant au pourquoi de la couleur du Petit Chaperon rouge, Michel Pastoureau nous rappelle que dans les campagnes, on habillait volontiers les enfants en rouge, pour mieux les surveiller.
À propos de rousseur. Dans la Bible, Judas n'est pas roux. Il le devient dans les représentations médiévales, car le roux est la couleur de cheveux la plus négative qui soit (même dans les pays germaniques !). Les traîtres et les menteurs, on en fait volontiers des roux. Seule exception notable : le bon roi David.